Grande première pour moi, j’ai pu participer à l’animation de communautés lors d’un événement culturel et scientifique dont tout le monde bibliothéconomique souhaiterait qu’on arrête de nous soûler avec (promis, on arrête très bientôt), je veux bien sûr parler de l’IFLA.
Constitution de l’équipe
En tant que volontaire, j’ai intégré l’équipe réseaux sociaux constituée de cinq personnes : Julie Arros, Isabelle Bontemps, Magalie Le Gall, Marine Vandermeieren et moi-même. Il s’agissait de l’animation spécifique au congrès (l’IFLA n’est pas que le congrès, ils y tiennent beaucoup).
Après avoir échangé par mail durant plusieurs mois pour se mettre d’accord notamment sur une liste d’outils et un planning, nous avons fait une première réunion de visu un mois avant l’événement. Elle a permis de caler la plupart des éléments, avec une autre réunion la veille du congrès.
Les outils
Concernant les outils, nous dépendions de l’IFLA auprès de qui nous devions motiver toute demande : par exemple, la demande d’un tumblr nous a été refusée car elle a été jugée redondante avec les pages du site dédiées à l’IFLA Express, équipe éditoriale qui relate le congrès au jour le jour. Alors que l’équipe éditoriale (textes pour parler de conférences, photos de qualité) bénéficiait d’une certaine reconnaissance, il s’agissait de la première fois qu’une équipe réseaux sociaux était constituée. Nous verrons plus loin que cela participera d’un sentiment pour l’équipe d’un procès en légitimité.
Les outils utilisés étaient donc Facebook, Twitter, Storify et Vine.
Les différences entre outils
Au sein de l’équipe, certains géraient déjà la page Facebook d’un établissement, Isabelle et Julie animaient les pages Facebook et Twitter depuis un an déjà, bref, nous avions tous des expériences significatives dans l’utilisation professionnelle de réseaux sociaux. De fait, certains étaient plus à l’aise avec l’un ou l’autre outil, et ce fut l’occasion d’apprendre les uns des autres.
Le fonctionnement en équipe
En effet, notre planning prévoyait de fonctionner en binôme : nous étions toujours deux à gérer les comptes, les trois autres étant invités à être des contributeurs secondaires sur ces plages horaires là. Il y avait donc un responsable Facebook, un responsable Twitter, ceci n’empêchant pas l’un de publier sur l’autre compte,
A mon sens, deux difficultés majeures étaient à gérer :
– le fait de devoir effectuer une veille continue sur les réseaux pour répondre aux éventuelles demandes et réagir tout en déambulant dans le centre de congrès à la recherche d’éléments à poster sur le vif
– mais également le fait de réaliser des Storifys. Convaincus de l’intérêt de réaliser quotidiennement un digest de la journée sur Twitter, nous n’avions pas prévu le caractère chronophage de l’outil (par ailleurs pas responsive design, je vous passe les détails). Nous nous sommes attelés chaque jour, midi et soir, à réaliser un storify quotidien. Cette bonne heure de travail nous empêchait de vraiment poster et veiller.
La ligne éditoriale
Quand j’écris que nous étions à la recherche d’éléments à poster, nous étions véritablement à l’affût. Nous nous étions entendus pour ne pas noyer les abonnés en fixant des limites de posts par outil et par demi-journée, sauf exception (par exemple, la soirée culturelle a été l’occasion de faire un lot important de Vine).
La ligne éditoriale était quant à elle claire : il s’agissait, en parallèle du site qui propose les papers des interventions et des pages de l’Ifla express qui proposent des recensions et des articles, de fédérer la communauté potentielle (présente et absente) autour de l’événement et de l’animer. Le ton devait être empreint d’un esprit « décalé », « décoiffant », ce qui, vous en conviendrez, n’est pas toujours aisé dans notre profession. Il s’agissait, comme l’écrit Isabelle, de « dépoussiérer l’image austère des congrès de bibliothécaires ».
Il ne s’agissait pas de livetweeter les sessions (nous n’aurions de toute façon pas eu les forces nécessaires pour) ni d’annoncer sobrement chaque événement important. Bien sûr, nous avions programmé des publications pour ne pas oublier les conférences inaugurales et autres rendez-vous incontournables, mais nous souhaitions avant tout proposer un cadre idéal pour une présence importante du congrès sur les réseaux sociaux en tentant de refléter une ambiance « décoiffante », mot d’ordre de la part des organisateurs français auprès des volontaires.
La barrière de la langue
Au niveau de la forme, une contrainte était de taille : communiquer en anglais et en français. Alors que l’IFLA possède 7 langues officielles, la langue dominante lors du congrès est l’anglais. Mais, le congrès se déroulant en France, le choix avait été fait en amont de poster systématiquement dans les deux langues.
Pour être honnête, j’aurais trouvé plus adapté de créer un compte [en] et un compte [fr] pour éviter de perdre en lisibilité, mais il a fallu composer avec cette contrainte. Il me semble que plus d’une fois, en particulier dans le cadre de posts courts et simples, nous n’avons écrit qu’en anglais. L’objectif était au maximum d’écrire dans les deux langues, séparées d’une barre oblique, dans le même post. Mais un tweet ne comportant que 140 caractères, ça n’en laisse que 70…
Cette question de la langue nous a valu une sévère critique sur Facebook, nous reprochant de ne communiquer qu’en anglais, ce qui de la part de l’équipe réseaux sociaux était faux, mais concernant le congrès (et ses pubs dans Lyon par exemple) peut-être vrai. C’est dans ces situations que nous nous rendons compte qu’étant en première ligne de la communication, on est facilement sujet à la critique, parfois violente…
Légitimité
C’est quoi le congrès de l’IFLA ? Je suis tranquillement installé chez moi ou au travail, souhaitant m’informer sur le congrès, je vais donc logiquement sur la page Facebook du congrès. Et là que vois-je ?
« Entre Disney et Voici », une page présentant zéro contenu, dans la superficialité la plus totale, bref : vraiment sans intérêt. Impossible de trouver sur Facebook la moindre information d’importance, on n’assiste qu’à un néant futile.
Cette phrase, nous l’avons lue (en d’autres termes, mais avec ce ton et ces critiques) le jour de la fin du congrès, alors que nous nous apprêtions à réaliser le débriefing.
Effectivement, animer des communautés, ce n’était pas ici faire état des grands débats qui se tenaient dans les allées du congrès, ni les résumés des sessions : ceux-ci étaient ailleurs, et ce n’était pas notre mission. Le fait d’avoir lu cette critique sur la page Facebook d’une professionnelle des bibliothèques m’a vraiment étonné : soit nous avions commis une énorme erreur en animant les communautés alors que les personnes cherchaient seulement le contenu (même si nous avions régulièrement fait référence à des liens vers du contenu, site du congrès et programme), soit cette critique n’était pas justifiée. N’hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous partagez son avis, nous nous sommes peut-être effectivement trompés (je ne peux malheureusement pas citer cette personne, celle-ci m’a supprimé de ses amis Facebook).
Une autre critique, mais je peux dire que je m’attendais à celle-ci, vient de la surexposition des personnes derrières les comptes officiels. Afin de rendre les comptes vivants, de les incarner et d’inciter les utilisateurs à se mettre en avant (Vine, portraits de congressistes, selfies), nous nous sommes mis en scène, donnant clairement de notre personne et, je le crains, nous plongeant dans le ridicule plus d’une fois. Alors que je n’étais souvent que modérément fier de voir ma trombine en vidéo tourner en boucle, il m’a été douloureux de m’entendre dire que je faisais preuve de narcissisme. Communiquer, c’est se prêter aux critiques les plus directes, et en l’occurrence je trouve plutôt efficace de mettre en scène le vivant ainsi. Là encore, n’hésitez pas à critiquer cela, il y a sûrement d’autres moyens d’engagements auxquels nous n’avons pas pensé.
Bilan et perspectives
Au final, notre mission a été remplie d’après moi. Comme le signalait Isabelle Bontemps sur Facebook, ce congrès fut l’occasion d’un échange considérable de tweets sur le hashtag officiel #wlic2014 (pourtant peu parlant ;-). L’apparition rapide d’un hashtag off ( #vlouic, essentiellement francophone) montre également le succès de la manifestation d’après moi, même si c’est inévitablement le lieu de critiques sur l’organisation ou des interventions.
Je souhaite à l’équipe projet du congrès 2015 le même succès que nous. Ils n’auront pas de contrainte linguistique car je suppose qu’ils ne communiqueront qu’en anglais. Peut-être qu’un rapprochement avec l’équipe rédactionnelle de l’IFLA Express pourra être envisagée. Enfin, je souhaite à leurs congressistes une meilleure connexion Wifi que la nôtre qui, bien qu’efficace, ne fonctionnait que par sessions de 15 minutes, ce qui pouvait être décourageant. Rendez-vous en août prochain au Cap ?
Note :
Quelques chiffres, pas forcément parlants :
Plus de 2 600 J’aime sur la page officielle
Plus de 26 000 tweets avec le hashtag officiel
Plus de 12 000 loops sur le Vine officiel
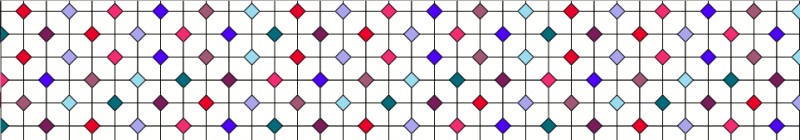


Je n’ai suivi le congrès que via Twitter, et encore, pas autant que je l’aurais aimé car je suis en prise avec mon « cher » mémoire. J’ai beaucoup apprécié la communication numérique : je suivais à la fois le compte « officiel » et celui de plusieurs bénévoles. J’ai apprécié le juste équilibre entre les LT des conférences (en particulier ceux d’Anne-Sophie Pascal et des gens du DL du web à la BnF) et les tweets de #vlouic. Ça donnait très envie d’être parmi vous, de participer à l’événement. L’intérêt de cette communication était de donner aux absents un aperçu de la « matérialité » de l’événement : pas seulement des conférences, mais aussi beaucoup de gens venus du monde entier, des posters nombreux et multicolores, un lieu physique..
Concernant la com’ sur les réseaux sociaux, le même débat fait toujours rage à propos de museomix… l’équilibre est tellement difficile à trouver et il est quasi impossible de contenter tout le monde!
[…] l’organisation du congrès) : le billet de Thomas Chaimbeauld , ceux de Thomas Colombera (l’animation des réseaux sociaux du congrès, le poster de la BN de Singapour en faveur de la lecture des jeunes; le poster sur […]
[…] : Storify de Silvère Mercier, article résumé de Sophiebib, Hortensius parle de son expérience de responsable réseaux sociaux pendant le congrès, retour de Thomas Chaimbault sur l’IFLA […]
[…] de Thomas Colombéra : l’animation des réseaux sociaux du congrès, le poster de la BN de Singapour en faveur de la lecture des jeunes; le poster danois […]
[…] de Thomas Colombéra (@Hortensius) : l’animation des réseaux sociaux du congrès, le poster de la BN de Singapour en faveur de la lecture des jeunes; le poster danois […]
[…] de Thomas Colombéra (@Hortensius) : l’animation des réseaux sociaux du congrès, le poster de la BN de Singapour en faveur de la lecture des jeunes; le poster danois […]